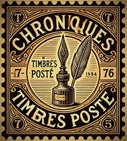Archives 2025
Octobre 2025
L’Algérie rend hommage à la mémoire palestinienne
En 2025, la situation diplomatique au Proche-Orient reste extrêmement tendue, notamment dans la bande de Gaza, où les affrontements se sont intensifiés malgré des efforts diplomatiques en cours.
Le 5 octobre, des frappes israéliennes ont causé la mort d’au moins 24 Palestiniens, alors même que des négociations étaient prévues en Égypte autour d’un plan de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis.
Sur le terrain, la population civile subit une crise humanitaire sans précédent : l’ensemble des habitants de Gaza est en situation d’insécurité alimentaire grave et de nombreuses infrastructures essentielles ont été détruites ou gravement endommagées.
Rappelons qu’à la suite de la proclamation de l’État d’Israël, le 14 mai 1948, entre 700 000 et 800 000 Palestiniens furent contraints de fuir ou furent expulsés de leurs terres et villages.
Cette tragédie, connue sous le nom de Nakba (النكبة), c’est-à-dire « la catastrophe » en arabe, s’accompagna de la destruction de plus de 400 villages et marqua le début d’un exil toujours en cours pour beaucoup.
Alors que la communauté internationale multiplie les appels à la désescalade, la réalité sur place pour les habitants demeure marquée par la violence, la précarité et une profonde incertitude politique.
Le 75ᵉ anniversaire de la Nakba
Émis le 24 mai 2023, ce timbre-poste algérien rend hommage au 75e anniversaire de la Nakba :

À travers une composition à la fois sobre et puissante, le timbre illustre la mémoire collective et la résistance culturelle du peuple palestinien en exil depuis plus de sept décennies. À gauche, on remarque une clé enveloppée d’un keffieh noir et blanc :

Popularisé par Yasser Arafat, dirigeant historique de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), le keffieh noir et blanc incarne l’unité nationale et la résistance du peuple palestinien face à l’occupation. Le noir et le blanc évoquent également les racines rurales et populaires du mouvement palestinien, notamment en Cisjordanie, d’où ce modèle est originaire.
La clé représente les maisons que les Palestiniens ont dû abandonner. Elle incarne la mémoire du déracinement, transmise de génération en génération, et représente pour beaucoup l’espoir d’un retour, d’une justice historique et d’une reconnaissance des souffrances vécues.
À droite, la mosquée Al-Aqsa, située à Jérusalem, est le troisième lieu saint de l’islam, après La Mecque et Médine :

Au-delà de sa valeur religieuse, cette mosquée est devenue un emblème de l’identité palestinienne et de la résistance face à l’occupation. Elle incarne la souveraineté palestinienne sur Jérusalem, ville revendiquée comme capitale, et son image exprime la volonté de préserver la présence palestinienne dans la cité.
Les inscriptions en arabe, en anglais et en tifinagh témoignent de la diversité linguistique et culturelle de l’Algérie ; le tifinagh est l’alphabet traditionnel des Amazighs (Berbères), peuple autochtone d’Afrique du Nord :

Son utilisation sur un timbre-poste est un symbole fort de l’identité amazighe et exprime la fierté et la continuité de cette civilisation millénaire.
Alors que la situation au Proche-Orient demeure marquée par des tensions et des violences persistantes, ce timbre-poste prend une résonance particulière : la question palestinienne est plus que jamais au cœur des débats internationaux.
La crise humanitaire, les négociations diplomatiques fragiles et les mobilisations populaires se succèdent, sans que les aspirations fondamentales à la justice ne soient pleinement satisfaites.
En mettant à l’honneur ce timbre, l’Algérie réaffirme son soutien historique et constant au peuple palestinien et invite les générations actuelles à se souvenir, à comprendre et à transmettre cette mémoire.
R. Simard
Septembre 2025
De Iwo Jima au 11 septembre : le courage américain à l’épreuve
Planter un drapeau est plus qu’un geste : c’est inscrire dans l’histoire la force d’un peuple face à l’épreuve.
Les Héros de 2001
Moins d'un an après les attentats du 11 septembre 2001, l'US Postal Service a émis un timbre-poste qui allait rapidement devenir un symbole de la résilience américaine :

Heroes of 2001
États-Unis, 7 juin 2002
Le visuel de ce timbre n’a pas été choisi au hasard : il immortalise la célèbre photographie de Thomas E. Franklin, dans laquelle trois pompiers new-yorkais hissent le drapeau américain sur les décombres du World Trade Center.
Ce jour-là, les pompiers furent plongés au cœur d’un chaos indescriptible. L’ampleur du désastre défiait toute logistique et rendait impossible l’élaboration d’un plan d’action structuré.
Les ascenseurs de l’immeuble étant hors service, des centaines de pompiers ont entrepris l'ascension de ses tours à pied, afin d’atteindre les victimes piégées dans les étages supérieurs.
Chaque instant était dominé par la menace d’un effondrement imminent. L’ordre d’évacuer la tour Nord a été donné de justesse, juste avant son écroulement. Mais la tour Sud, elle, s’est abattue sans prévenir, ensevelissant de nombreux secouristes.
Le prix payé pour ce courage hors du commun fut immense : 343 pompiers perdirent la vie dans l’exercice de leur devoir, faisant de cette journée la plus meurtrière de l’histoire du Fire Department of the City of New York.
Et le sacrifice ne s’arrêta pas là : dans les années qui suivirent, des centaines d’autres furent affectés par des maladies liées à l’exposition prolongée aux substances toxiques qui empoisonnaient encore l’air du site.
D'une valeur d'affranchissement de 34 cents (le tarif de la première classe en 2002), ce timbre-poste se vendait à cette époque 45 cents. Les 11 cents supplémentaires étaient versés au Fonds fédéral d’assistance aux héros de l’Amérique, en soutien aux secouristes et aux familles des victimes.
Le succès fut immense, avec plus de 133 millions d'exemplaires vendus, permettant de récolter plus de 10 millions de dollars.
Le drapeau américain à Iwo Jima
Le timbre-poste Heroes of 2001 fait écho à une autre émission philatélique américaine, parue 57 ans auparavant :

Iwo Jima
États-Unis, 11 juillet 1945
Iwo Jima rend hommage à une autre photographie célèbre de l'histoire américaine, prise le 23 février 1945 : Joe Rosenthal a saisi l’instant où six Marines plantaient un drapeau américain au sommet du mont Suribachi, lors de la terrible bataille d’Iwo Jima (Japon).
Cet affrontement fut l’un des plus meurtriers de la guerre du Pacifique, au point que l’amiral Chester W. Nimitz, qui commandait alors les forces navales américaines dans le Pacifique, en fit ce constat resté célèbre : « une valeur hors du commun y était une vertu commune ».
À Iwo Jima, les combats, acharnés et d’une violence extrême, se sont livrés mètre par mètre. Les soldats américains durent recourir à des lance-flammes et à des grenades pour déloger, un à un, les défenseurs japonais. Ceux-ci étaient retranchés dans un réseau de fortifications et de tunnels presque imprenables.
Cette résistance acharnée fit de l’île un champ de bataille de 36 jours, au terme desquels près de 7 000 Marines perdirent la vie et plus de 20 000 autres furent blessés.
Hommage à la bravoure et à la résilience
Bien que séparées par plus d'un demi-siècle, ces deux timbres-poste forment un diptyque puissant : l'un incarne la victoire militaire et le sacrifice des combattants, l'autre la victoire morale et la résilience d'une nation face au chaos.

Dans les deux cas, le simple geste de planter un drapeau est un acte fondateur, unifiant une nation autour d'un récit de courage et d'espoir.
R. Simard
Août 2025
Grosse-Île : un mémorial de la Grande Famine irlandaise
Entre 1845 et 1852, l’Irlande a été frappée par une terrible famine causée par le mildiou, une maladie de la pomme de terre.
La pomme de terre étant l’aliment de base de la population irlandaise, des milliers de personnes ont été plongées dans la misère et la faim.
On estime qu’environ un million d’Irlandais en sont morts et qu’un autre million a émigré pour fuir la crise.
Le timbre-poste ci-dessous, émis le 4 mai 1982 par la poste irlandaise, rend hommage à cette période sombre de l’histoire d’Irlande :

Il appartient à une série européenne (EUROPA) rassemblant 34 pays, dont le thème central était « les événements historiques ».
On y voit une femme et deux enfants fouillant la terre, symbole de la détresse causée par la perte des récoltes.
L’illustration évoque la souffrance des familles paysannes irlandaises et leur dépendance à la pomme de terre pour leur alimentation.
Le gouvernement britannique a été accusé d'avoir délibérément abandonné l'Irlande durant les années de la Grande Famine, en raison de la politique du laissez-faire qu’il avait adoptée.
Le laissez-faire est une doctrine économique selon laquelle le gouvernement doit laisser la libre concurrence réguler l'économie d’une société : « La seule fonction légitime du gouvernement est la défense des riches contre les pauvres, ou ceux qui ont quelque propriété contre ceux qui n’en ont pas du tout » écrivait Adam Smith dans son célèbre ouvrage La Richesse des nations (1776).
Dans cette perspective, les dirigeants britanniques estimaient que toute aide aux Irlandais risquait de perturber le marché et d'engendrer une dépendance de la population envers l'État.
L'inaction britannique a jeté les bases d'une conscience nationale plus forte en Irlande et a alimenté la lutte pour l'indépendance de ce pays qui allait culminer au début du XXe siècle.
Le texte « An Gorta Mór 1845-1850 » (La Grande Famine 1845-1850) rappelle que le gaélique irlandais est la langue nationale et la première langue officielle de l’Irlande :

Devant leur situation désespérée, de nombreux Irlandais ont décidé de s'exiler pour survivre. Le Canada est devenu une destination de choix. Entassés dans des navires surnommés « les bateaux cercueils », un nombre élevé de ces émigrés ont trouvé la mort durant la traversée de l’Atlantique.
Grosse Île, au Québec, est un lieu important en lien avec cette tragédie. Située dans le fleuve Saint-Laurent, cette station de quarantaine a accueilli un grand nombre d'Irlandais qui cherchaient refuge au Canada.
En 1847, l’année la plus tragique de la famine, des milliers de malades y furent accueillis dans des conditions précaires. Les installations sanitaires de Grosse Île ont été débordées et le personnel ne suffisait pas à la tâche.
On estime qu'environ 5 424 personnes sont décédées à Grosse Île cette année-là. La majorité de ces victimes étaient des immigrants irlandais affaiblis par la famine et le voyage.
Grosse Île est aujourd’hui une destination touristique fascinante, particulièrement au mois d'août. Les visiteurs peuvent y découvrir les traces matérielles de la station de quarantaine, tels que des bâtiments, des cimetières et des monuments.
Érigée en 1909, cette croix celtique est un mémorial en l'honneur des milliers d'immigrants irlandais qui ont péri du typhus sur l'île en 1847-1848 :

Les installations de Grosse Île comprenaient des douches dans lesquelles les nouveaux arrivants devaient « se désinfecter » avant d'être mis en quarantaine :

Ces douches témoignent des mesures extrêmes de santé publique prises à l'époque pour protéger le Canada des épidémies importées.
Après la pandémie de la COVID-19, la visite de Grosse Île permet de réfléchir au passé à la lumière de notre expérience récente. Grosse Île un lieu chargé d’émotions et d’histoire, qui offre un lien poignant entre les défis d’hier et ceux d’aujourd’hui.
La compagnie Croisières Lachance détient l'exclusivité de l'accès à l'île et offre le transport aller-retour en bateau ainsi que la visite guidée. Le lieu d'embarquement est situé à Berthier-sur-Mer, une petite ville à l'est de Québec sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.
R. Simard
Juillet 2025
Aux origines de l’unité canadienne
Le 1ᵉʳ juillet est la fête nationale du Canada. Cette journée marque la naissance officielle du pays en 1867, lorsque quatre provinces se sont unies pour former la Confédération canadienne : le Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.
À cette époque, la crainte d’une annexion américaine, renforcée par la guerre de Sécession et l’expansion territoriale des États-Unis, avait incité les dirigeants canadiens à rechercher une unité.
Ils cherchaient également à affirmer l’autonomie du Canada face au Royaume-Uni. Ils souhaitaient, toutefois, maintenir des liens stratégiques avec l’Empire britannique, afin de se protéger des ambitions américaines et d’assurer la propre pérennité du Canada dans une Amérique du Nord en pleine mutation.
Le timbre-poste ci-dessous a été émis le 29 juin 1927 pour célébrer le 60e anniversaire de la Confédération canadienne. Il est un bel exemple de la manière dont le Canada a commémoré sa propre construction nationale :

Il montre une carte du Canada avec deux dates importantes : 1867, année de la fondation du pays, et 1927, étape du chemin parcouru depuis.
Cette carte est illustrée à l’aide de deux teintes distinctes de bleu qui montrent l’évolution territoriale du pays. Le bleu foncé correspond aux quatre provinces fondatrices du Canada en 1867 :

La région colorée en bleu pâle montre les provinces qui se sont jointes à la Confédération canadienne jusqu’en 1927 :
- Le Manitoba (1870) ;
- La Colombie-Britannique (1871) ;
- L'Île-du-Prince-Édouard (1873) ;
- La Saskatchewan et l’Alberta (1905).
La numérisation du timbre a créé des variations chromatiques qui ne sont pas visibles sur l’original. Ce phénomène est fréquent avec les encres foncées : selon la lumière, l’angle de prise de vue ou la qualité du support, des tons violacés ou verdâtres peuvent apparaître.
Au-dessus de la frontière canado-américaine, on remarque deux lignes foncées qui traversent le pays jusqu’à l’extrémité ouest. Elles représentent les deux chemins de fer transcontinentaux du Canada, symboles majeurs de l’unification canadienne :
- Le Canadien Pacifique (CP) a été le premier chemin de fer à relier l'est du Canada (Montréal/Toronto) à la côte ouest (Vancouver) ;
- Le Canadien National (CN) a été créé par la fusion de plusieurs compagnies ferroviaires et est devenu une autre ligne transcontinentale importante.
Entre 1867 et 1927, le Canada est ainsi passé de 4 à 9 provinces. Il faudra attendre en 1949 pour que s’ajoute l'île de Terre-Neuve, qui formera la dixième province canadienne. [1]
Une frontière paisible, une identité à défendre
Les enjeux contemporains rappellent parfois les préoccupations du passé. Les discussions sur la sécurité des frontières, la coopération militaire dans le cadre de l’OTAN ou de NORAD ou encore les tensions commerciales récentes montrent que l’indépendance et l’unité du Canada demeurent encore pertinentes.
Bien que le Canada soit devenu une confédération pour se distinguer des États-Unis, il partage avec ce pays la plus longue frontière non militarisée du monde, un symbole fort de la confiance et de la coopération qui existe entre les deux pays.
Cela ne veut pas dire pour autant que les débats sur l'identité et la souveraineté canadienne aient disparu. L'influence économique et culturelle des États-Unis demeurera encore longtemps une donnée importante dans la réalité canadienne .
Célébrer le 1ᵉʳ juillet au Canada, c’est reconnaître le chemin parcouru depuis une époque où l’avenir de ce pays était incertain. Aujourd’hui, il demeure un acteur mondial stable et indépendant, mais profondément interconnecté avec son voisin.
R. Simard
Note
[1] Au Canada, faut distinguer les provinces des territoires : les provinces tirent leur pouvoir directement de la Constitution canadienne. Elles sont des entités souveraines dans les domaines de compétence qui leur ont été attribués par la Loi constitutionnelle de 1867. Les territoires ne tirent pas leur pouvoir de la Constitution, mais d’une délégation de compétences accordée par le Parlement canadien. Cela signifie que le gouvernement canadien peut modifier les pouvoirs qui leur sont accordés, s’il le souhaite. Les territoires canadiens sont les suivants : les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut.
Juin 2025
La Crimée en 1991–1992 : une région en crise d'identité
En 1991, après la chute de l’URSS, l’Ukraine est devenue indépendante. La Crimée, qui était une république autonome au sein de la RSS d’Ukraine depuis 1954, se retrouva automatiquement intégrée à l’Ukraine indépendante.
Beaucoup d’habitants de Crimée, majoritairement russophones, étaient hostiles à cette intégration. Ils se sentaient historiquement et culturellement liés à la Russie. Certains souhaitaient rester dans un espace post-soviétique ou même être rattachés à la Russie.
Le 20 janvier 1991, un référendum avait donné une majorité en faveur du rétablissement de la République autonome de Crimée.
Le 5 mai 1992, le Parlement de Crimée a même proclamé l’indépendance de la Crimée. Celle-ci fut suspendue le 22 mai sous la pression de Kiev.
C’est dans ce contexte que des stocks de timbres-poste soviétiques ont été surchargés localement. L’exemple ci-dessous présente les caractéristiques suivantes :

- Le mot « КРИМ » désigne la Crimée ;
- Le Trident est le symbole officiel de l’Ukraine indépendante.
Ces timbres-poste n’ont jamais été émis par l’administration postale ukrainienne. Ils ne sont pas officiels et sont considérés comme des timbres de fantaisie. Cependant, ils portent un message fort : « La Crimée est ukrainienne ».
Ce timbre est un acte philatélique chargé politiquement : il ne reflète pas la volonté majoritaire de la Crimée en 1992 ; il exprime la volonté de l’Ukraine de maintenir son intégrité territoriale.
Il incarne le conflit d’identités qui a atteint son paroxysme le 18 mars 2014 avec l’annexion de la Crimée à la Russie – un acte qui, en 2025, demeure toujours non reconnu par la communauté internationale.
R. Simard
Mai 2025
Le dernier chapitre d'une icône canadienne : la Compagnie de la Baie d'Hudson
Le timbre-poste ci-dessous a été émis par le Canada le 15 septembre 1999, dans le cadre d’une série philatélique rappelant les grandes réalisations canadiennes au tournant du millénaire. Il représente la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC), le plus ancien commerce du Canada :

Le 2 mai 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson a été fondée grâce à une charte royale promulguée par le roi Charles II d'Angleterre. Cette charte accordait à la compagnie un monopole exclusif sur le commerce des fourrures dans une vaste région du Canada actuel.
Ce monopole a permis à la compagnie de devenir l'une des entreprises les plus puissantes du monde à cette époque et de consolider la position des Britanniques dans le commerce des fourrures en Amérique du Nord.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la demande de fourrures en Europe était très forte. Les peaux de castor étaient particulièrement prisées pour la fabrication de chapeaux de feutre, un accessoire de mode et un symbole de statut social essentiels à cette époque.
Les Européens échangeaient des produits avec les peuples autochtones contre des peaux de castor. Parmi les articles les plus appréciés par les Amérindiens, figuraient les toiles et les couvertures de laine, de coton ou de lin. Ces articles étaient prisés pour leur longévité, leur solidité et leur beauté.
La convoitise des Amérindiens pour les tissus européens n’est pas sans rappeler la fascination des Inuits pour les tissus rouges des colons scandinaves lorsque les deux cultures ont cohabité au Groenland durant le Moyen Âge. (voir La philatélie au service de l'actualité : l'histoire du Groenland.)
L'illustration sur le timbre-poste montre un Européen et un Autochtone. La proximité de ces personnages symbolise la relation commerciale qui a existé entre la Compagnie de la Baie d’Hudson et les peuples des Premières Nations du Canada :

L’Européen représente les marchands impliqués dans le commerce des fourrures, tandis que l'Autochtone représente les intermédiaires qui fournissaient les fourrures.
Les rayures de couleur devant les personnages font référence à la célèbre couverture à points de la Compagnie de la Baie d'Hudson :

Introduites au Canada en 1779, ces couvertures de laine aux rayures de couleur étaient produites en Angleterre pour le commerce des fourrures. Elles étaient utilisées par la compagnie comme monnaie d'échange avec les Autochtones contre des peaux de castor.
Les couvertures de la Compagnie de la Baie d’Hudson ont acquis au fil du temps une signification symbolique. Elles sont devenues un emblème du Canada, représentant l'histoire partagée entre les peuples autochtones et les colons européens.
Ces couvertures ont continué à être fabriquées pour la vente au détail, figurant sur les rayons des magasins La Baie. Elles ont été parmi les objets qui ont disparu rapidement lorsque l’entreprise a annoncé la fermeture définitive de ses magasins et la liquidation de toute sa marchandise.
À la fin du XIXe siècle, la Compagnie de la Baie d’Hudson s'est diversifiée en introduisant des articles de consommation courante dans ses magasins à grande surface.
Au cours du XXe siècle, la compagnie a ouvert de nombreux magasins à travers le Canada, s'imposant comme un lieu d'achat incontournable.
La Baie, forme brève du nom de l’entreprise depuis 1965, était connue pour son large éventail de produits, allant des vêtements aux bijoux, des meubles aux articles ménagers, des jouets aux parfums, etc.
Sur le timbre-poste, on aperçoit en haut à gauche un canoë qui semble en mouvement. Cet élément est une référence directe aux peuples autochtones et aux trappeurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson : ce moyen de transport était essentiel pour leurs déplacements dans les régions isolées du Canada :

En filigrane de cette représentation, on reconnaît le B stylisé représentant la marque La Baie. Créé en 1965, ce logo est devenu le symbole moderne de la Compagnie de la Baie d’Hudson et a constitué un ancrage visuel fort pour l'entreprise.
En 1970, à l’occasion du tricentenaire de la compagnie, une nouvelle charte a été signée par la reine Élisabeth II : la Compagnie de la Baie d’Hudson a été transférée du Royaume-Uni au Canada et son siège social de Londres à Winnipeg.
Plus près de nous, l’entreprise a traversé une période difficile marquée par des tentatives d’adaptation aux nouvelles réalités du commerce. La concurrence accrue des détaillants en ligne, les changements dans les habitudes des consommateurs et des problèmes financiers internes ont malheureusement signé la fin de ce fleuron de l’histoire du Canada.
En avril 2025, après avoir déposé une demande de protection contre ses créanciers, La Baie a pris la décision de fermer définitivement tous ses magasins, mettant fin à une marque emblématique de l'histoire commerciale canadienne.
Le timbre-poste présenté dans cet article est une belle représentation de l’histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, de ses liens avec les Premières Nations du Canada et du rôle fondamental que cette entreprise a joué dans la construction du pays en tant que nation de commerce et d'échanges.
La Compagnie de la Baie d’Hudson restera un symbole marquant de l'histoire canadienne, même si la fermeture de ses magasins en 2025 signe la fin de cette institution.
R. Simard
Avril 2025
« Un siècle d'amitié États-Unis - Canada »
Le timbre-poste suivant, émis par les États-Unis le 2 août 1948, célèbre le « centenaire de l’amitié entre les États-Unis et le Canada ». Il incarne une relation historique entre les deux nations voisines, fondée sur la coopération et des liens amicaux durables.

Ce timbre-poste, gravé en taille-douce, représente le majestueux pont suspendu des chutes du Niagara. Construit de 1851 à 1855, ce pont incarne les liens historiques et économiques qui ont unis le Canada et les États-Unis pendant un siècle.
Ce chef-d'œuvre d'ingénierie reliait la rive canadienne des chutes du Niagara à celle de l'état de New York aux États-Unis. Il a été le premier pont ferroviaire suspendu au monde.
Conçu pour une utilisation polyvalente, ce pont a été construit pour faciliter les échanges et les déplacements. Il présentait deux tabliers superposés : le tablier supérieur était réservé à la circulation des trains, tandis que le tablier inférieur accueillait les piétons et les voitures à cheval. La finesse de la gravure permet de bien les distinguer :

Au cours de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, le pont suspendu des chutes du Niagara a joué un rôle important dans le commerce transfrontalier canado-américain. Chaque année, environ 12 millions de dollars de marchandises transitaient par cette voie. [1]
La décision de sa construction s'inscrivait dans la volonté de renforcer le commerce bilatéral entre le Canada et les États-Unis. Le traité de réciprocité, négocié à partir de 1848 et rendu officiel en 1854, avait pour but d'éliminer ou de réduire les tarifs douaniers (!) sur des marchandises importantes dans les échanges entre les deux pays.
Il est intéressant de mentionner que ce pont a joué un rôle humanitaire important lors de la guerre de Sécession (1861-1865). Il a offert aux esclaves en fuite depuis le sud des États-Unis un passage vers le Canada, leur permettant de retrouver leur liberté.
En 1897, le pont suspendu fut remplacé par le pont des rapides Whirlpool, qui demeure aujourd’hui une structure importante reliant les deux rives de la rivière Niagara.
Les relations actuelles entre le Canada et les États-Unis contrastent beaucoup avec celles ayant eu cours au XIXᵉ siècle. Bien que les liens entre les deux pays soient encore puissants, ils sont soumis aujourd'hui à des défis bien différents de ceux qui ont permis la construction du célèbre pont représenté sur le timbre-poste.
R. Simard
Référence
[1] RYERSON, Egerton, HODGINS, John (1854), « The Niagara Suspension Bridge », The Journal of Education for Upper Canada, 8 (10), Toronto, Canada: Lovell and Gibson, Archived from the original on March 1, 2024. Consulté le 30 mars, 2025.